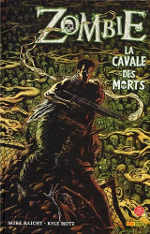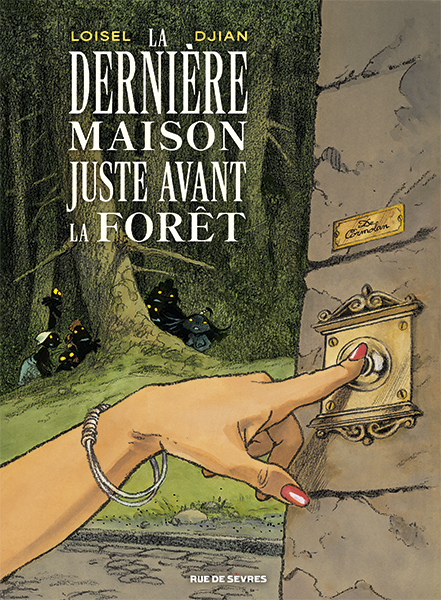Batman : The killing joke (Alan Moore & Brian Bolland) – Panini Comics

L’ère du numérique a profondément bouleversé tant la musique que le cinéma, avec force remasterisations et/ou restaurations à la clé. Avec des résultats inégaux, parfois carrément géniaux (la version made in Iggy Pop lui-même de l’album « Raw power » des Stooges), parfois catastrophiques (genre la colorisation des films en noir et blanc), tout dépendant la plupart du temps de qui effectue ces « modernisations » et, surtout, des motivations plus ou moins mercantiles qui sous-tendent ces projets.
Jusqu’à présent la BD avait plus ou moins été épargnée par le phénomène (exception faite, bien sûr, des coupes sombres imposées par la censure en certaines occasions). Désormais il faudra peut-être compter avec la remise au goût du jour de certains albums, même (et peut-être surtout) les plus essentiels.
En ce sens, la nouvelle édition de Batman : The killing joke, signée Alan Moore pour le scénario et Brian Bolland pour le dessin, initialement parue en 1988, risque de marquer une nouvelle étape dans la réappropriation, par leurs auteurs, de certaines de leurs histoires.
Comme l’explique Brian Bolland en postface de cet album, à l’époque, 88 donc, quand cette histoire est parue, directement en graphic novel d’ailleurs, et non pas dans une des revues régulières consacrées à Batman, il ne lui était pas possible de coloriser lui-même ses dessins. Ce qui est d’ailleurs très souvent le lot des dessinateurs de comics américains, qui travaillent souvent sur plusieurs projets en parallèle, et qui courent donc après le temps qui leur fait cruellement défaut. Et même si Bolland avait une idée assez précise de ce qu’il voulait en terme de couleurs, il n’a jamais fait mystère de sa déception face au travail de John Higgins. Aussi a-t-il sauté sur l’occasion, en 2007, quand DC a décidé de republier cette histoire, pour demander à l’éditeur d’avoir la possibilité de refaire entièrement les couleurs de « The killing joke ». Ce qui lui fut accordé.
Et le résultat est MAGISTRAL ! N’ayons pas peur de le dire !
« The killing joke » est une histoire très dure, très sombre, l’une des premières qui verra l’univers de Batman entrer dans une ère de violence, de cynisme, de désabusion, qui perdure encore aujourd’hui, et qui, je dois dire, correspond parfaitement à la schizophrénie du personnage et à la folie qui émane des vilains que le Chevalier Noir combat régulièrement.
« The killing joke » est un album fondateur en ce sens qu’il est l’un des premiers à mettre en avant la véritable folie meurtrière du Joker, violence gratuite la plupart du temps, mais une violence qui anime en permanence le Clown, Prince du Crime. Fondateur aussi en ce sens qu’il va, par ricochet, être responsable de l’apparition d’un nouvel allié de Batman, en l’occurrence Oracle. En effet, c’est dans « The killing joke » que Barbara, la fille du commissaire Gordon, et la première Batgirl du nom, se fait tirer dessus par le Joker, la balle qu’elle reçoit dans la colonne vertébrale la condamnant à passer le reste de sa vie dans une chaise roulante. Bien plus tard, une fois remise de sa blessure, elle mettra ses immenses talents d’informaticienne au service de Batman et de la police de Gotham sous sa nouvelle identité d’Oracle. Fondateur encore puisque, sous forme de flash-backs, on y apprend comment un minable comique de music-hall raté deviendra, par accident, le redoutable Joker.
Mais, au-delà de la violence du Joker, on voit aussi dans « The killing joke » apparaître une autre facette de la personnalité du criminel : son sens de la mise en scène macabre et vicieuse. En effet, dans cet album, le Joker va tenter de briser psychologiquement le commissaire Gordon en l’humiliant physiquement d’abord puis en lui montrant des photos de sa fille prises juste après l’agression. Le commissaire Gordon sera finalement sauvé par l’arrivée de Batman (comment pourrait-il en être autrement) dans le parc d’attractions désaffecté qui sert de QG au Joker, au milieu de phénomènes de foire dignes des « Freaks » de Tod Browning. La bataille finale entre le justicier et le criminel est un réel moment d’anthologie de toute l’histoire des comics… Notamment avec une chute pour le moins ambiguë et qui fait toujours débat aujourd’hui quand à la relation qui peut exister entre Batman et le Joker… Mais je vous laisse le soin de la découvrir par vous-même si vous n’avez jamais lu cette histoire.
Pour en revenir à la nouvelle colorisation signée Brian Bolland himself (pour le scénario, le simple fait de dire qu’il est d’Alan Moore est à lui seul une preuve de qualité, même si, curieusement, le créateur des Watchmen a toujours déclaré qu’il n’aimait pas franchement cette histoire, peut-être parce qu’il n’en était pas lui-même à l’origine, l’idée étant venue initialement de Bolland), elle accentue le côté violent, insane et complètement amoral en jouant énormément sur les ambiances, nocturnes bien sûr, mais aussi glauques et cafardeuses, là où celle d’Higgins, d’un seul coup très datée quand on la compare à la nouvelle, jouait sur les codes de l’époque sans trop tenir compte de l’environnement. L’un des coups de génie de Bolland est surtout d’avoir traité les séquences de flash-backs dans une atmosphère de noir et blanc tendance sépia, avec juste une tache de couleur de ci de là (une écrevisse au rouge éclatant, ou encore le casque de Red Hood, lui aussi d’un écarlate qui tranche sur le noir et blanc de ces double pages rétroactives), ce qui rehausse le rapport au cinéma qui est souvent avancé quand il s’agit de BD savamment découpées, montées et scénarisées.
Bref, Brian Bolland a enfin pu avoir l’occasion de voir son histoire publiée telle qu’il la voyait dans son imagination quand il la dessinait, ce qui n’est que justice.
Et comme l’histoire ne fait que cinquante pages, on a droit, en complément, à une introduction signée Tim Sale, la postface de Bolland donc, une mini histoire de 8 pages, « Un parfait innocent », dont Bolland a signé le scénario, le dessin… et les couleurs évidemment, complètement surréaliste et qui explore, elle aussi, les méandres psychotiques d’un type qui espère transcender la banalité de son existence grâce à une action d’éclat, mais je n’en dit pas plus, je vous laisse la surprise. Et pour finir, Bolland nous livre deux pages de crayonnés commentés, exercice de style toujours bienvenu pour tenter de comprendre le cheminement intellectuel d’un dessinateur de talent.
Une « Edition deluxe » comme il est précisé en sous-titre, ce qui n’est franchement pas une affirmation mensongère.
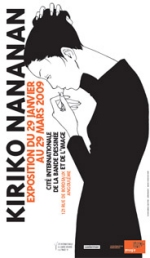

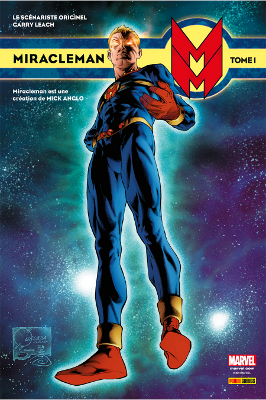

- - 17731 séries
- - 30129 oneshots
- - 1784 périodiques et revues
- - 33503 auteurs
- - 2560 éditeurs